Skip to content
La population de loups en France
Après des siècles d’acharnement ayant failli le faire disparaître en Europe, le loup a été sauvé in extremis par une protection légale. Depuis 1979, il est protégé au niveau européen par la Convention de Berne transcrite dans le droit français en 1989. Le loup est protégé en France par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993 mis à jour le 23 avril 2007. Et le loup est inscrit dans les annexes II et IV de la directive Habitats Faune Flore de l’Union européenne (92/43/CEE), au titre d’espèce prioritaire.
Cela signifie que la France doit veiller à la conservation de l’espèce et de ses habitats.
Début décembre 2024, sous la pression des organisations agricoles et malgré les alertes des associations de protection de l’environnement, la Convention de Berne — à laquelle appartient l’Union européenne — a baissé le niveau de protection du loup, le passant de « strictement protégé » à « protégé ».
La population de loups en France a été estimée à 1 013 individus, a indiqué la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes jeudi 12 décembre 2024. Ce nombre est quasiment stable par rapport à celui publié en mai 2023 (1 003 loups) mais en baisse par rapport au correctif publié en septembre 2023 (1 104 loups).
À noter qu’à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, la méthode CMR (capture-marquage-recapture) sera la seule utilisée pour estimer la population de loups. Elle est réputée plus fiable car elle repose sur l’identification individuelle des loups par leur profil génétique. Jusqu’à présent, cette méthode était croisée avec une première estimation produite en fin d’hiver par le Réseau loup-lynx.
En conséquence, 192 loups pourront être abattus en 2025, conformément au plan loup qui fixe le plafond d’abattage à 19 % de la population lupine. En 2023, l’État avait autorisé l’abattage de 204 loups.
D’après la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre d’attaques de loups a augmenté de 4,6 % et le nombre d’animaux prédatés de 10,6 %, principalement dans les territoires où le loup vient d’arriver.
Eradiqué en France en 1937, il y a fait son retour naturel en 1992, quand un couple venu naturellement d’Italie, où il n’avait jamais disparu, a été observé dans le Mercantour (sud des Alpes). Depuis, avec des effectifs en hausse de 15 à 20 % par an, il a colonisé tout l’arc alpin, se sent chez lui dans le Massif central, les Pyrénées, les Vosges et en Lorraine, et a été vu en Charente-Maritime, en Normandie, dans le Finistère ou la Somme. En septembre 2023, la population nationale était estimée à 1 104 individus dans 55 départements, contre 430 en 2018.
En mai 2024, la dernière estimation du nombre de loups présents en France est à 1 003 loups. Cette estimation fait état d’une baisse de la population de 9%, sachant qu’au mois de septembre 2023, la population lupine était estimée à 1 104 individus.
Discret et méfiant, le loup évite l’homme et s’éloigne en cas de rencontre. Entre 1999 et 2020, l’OFB a enregistré 3 880 interactions entre l’homme et le prédateur en France. « Seules 10 interactions étaient hostiles. Et à chaque fois, il s’est avéré que c’était dû au comportement de l’homme. (…) Il n’y a pas de psychose à avoir, » glisse Éric Hansen (Directeur Provence Alpes Cote d’Azur et Corse de l’Office Francais de la Biodiversité).
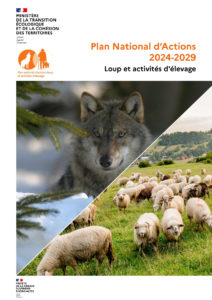
L’une des principales évolutions de ce plan est le changement de « statut » du loup, que le gouvernement souhaite faire passer « d’espèce très protégée » à « espèce protégée ». En France, c’est le credo principal du «plan loup» pour 2024-2029, dont les grandes lignes ont été présentées en septembre et qui devrait être publié dans les jours prochains, selon le ministère de la Transition écologique. Celui-ci prévoit notamment une simplification des procédures de tir, une hausse du taux de «prélèvement» si l’évolution de la population lupine le permet (il est actuellement fixé à 19 %, autorisant la «destruction» de 209 loups en 2024, comme l’année précédente) et la possibilité pour les éleveurs d’utiliser du matériel de vision nocturne afin de repérer l’animal.
D’après les défenseurs de l’environnement, les tirs du carnivore est une très mauvaise idée, qui ne résoudra même pas l’épineuse question de la prédation sur les troupeaux. D’abord, arguent-ils, il est faux d’affirmer que l’espèce est hors de danger. Selon la dernière évaluation de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), datant de 2018, sur les neuf populations transfrontalières de loups de l’UE, six sont vulnérables ou quasi menacées. En France, le loup est toujours classé «vulnérable». Et de souligner son rôle écologique crucial : en régulant les populations d’herbivores sauvages, il limite les dégâts causés par ces derniers dans les forêts et les cultures, comme le rappelle une étude scientifique de 2020.
Ensuite, les tirs létaux de loups n’ont pas démontré leur efficacité pour protéger les troupeaux. C’est d’ailleurs écrit dans le projet de plan loup, qui cite une thèse n’ayant pas permis de trancher. Celle-ci montre que «l’effet des tirs dépend du contexte local : s’ils peuvent être efficaces pour réduire la prédation dans certains cas, ils peuvent également se révéler inefficaces voire augmenter les niveaux de prédation dans d’autres cas», résumait le comité français de l’UICN en décembre. «Chasser les loups fait éclater la structure sociale de leurs meutes. C’est plus susceptible d’augmenter la prédation du bétail que de la réduire», estime aussi Ariel Brunner, de l’ONG Birdlife.
La gestion de l’espèce par les tirs – si telle était la volonté de l’Etat- doit avant tout reposer sur un objectif de gestion des attaques aux troupeaux et non de contrôle des effectifs. S’il est tentant d’aborder la question en indexant un nombre de loups à prélever sur l’effectif total de la population, cette approche est à éviter car les risques observés pour les troupeaux ne sont pas forcément directement proportionnels aux densités d’animaux, particulièrement sur les espèces territoriales et sociales comme le loup. Ainsi les mécanismes de compensations, ainsi que le caractère territorial et social d’une espèce comme le loup, empêchent toute relation proportionnelle entre le nombre de loups prélevés et le nombre d’attaques. Le système reste plus complexe qu’une simple corrélation, et le nombre d’attaques n’est pas uniquement lié au nombre de loups, mais aussi dépendant d’une multitude de facteurs biologiques, topographiques, ou encore humain.